-
- Art. 3 Cst.
- Art. 5a Cst.
- Art. 6 Cst.
- Art. 10 Cst.
- Art. 13 Cst.
- Art. 16 Cst.
- Art. 17 Cst.
- Art. 20 Cst.
- Art. 22 Cst.
- Art. 26 Cst.
- Art. 29a Cst.
- Art. 30 Cst.
- Art. 31 Cst.
- Art. 32 Cst.
- Art. 42 Cst.
- Art. 43 Cst.
- Art. 43a Cst.
- Art. 45 Cst.
- Art. 55 Cst.
- Art. 56 Cst.
- Art. 60 Cst.
- Art. 68 Cst.
- Art. 74 Cst.
- Art. 75b Cst.
- Art. 77 Cst.
- Art. 81 Cst.
- Art. 96 al. 1 Cst.
- Art. 96 al. 2 lit. a Cst.
- Art. 110 Cst.
- Art. 117a Cst.
- Art. 118 Cst.
- Art. 123a Cst.
- Art. 123b Cst.
- Art. 130 Cst.
- Art. 136 Cst.
- Art. 164 Cst.
- Art. 166 Cst.
- Art. 170 Cst.
- Art. 178 Cst.
- Art. 189 Cst.
- Art. 191 Cst.
-
- Art. 11 CO
- Art. 12 CO
- Art. 50 CO
- Art. 51 CO
- Art. 84 CO
- Art. 97 CO
- Art. 98 CO
- Art. 99 CO
- Art. 100 CO
- Art. 143 CO
- Art. 144 CO
- Art. 145 CO
- Art. 146 CO
- Art. 147 CO
- Art. 148 CO
- Art. 149 CO
- Art. 150 CO
- Art. 633 CO
- Art. 701 CO
- Art. 715 CO
- Art. 715a CO
- Art. 734f CO
- Art. 785 CO
- Art. 786 CO
- Art. 787 CO
- Art. 788 CO
- Art. 808c CO
- Dispositions transitoires relatives à la révision du droit de la société anonyme du 19 juin 2020
-
- Art. 2 LDP
- Art. 3 LDP
- Art. 4 LDP
- Art. 6 LDP
- Art. 10 LDP
- Art. 10a LDP
- Art. 11 LDP
- Art. 12 LDP
- Art. 13 LDP
- Art. 14 LDP
- Art. 15 LDP
- Art. 16 LDP
- Art. 17 LDP
- Art. 19 LDP
- Art. 20 LDP
- Art. 21 LDP
- Art. 22 LDP
- Art. 23 LDP
- Art. 24 LDP
- Art. 25 LDP
- Art. 26 LDP
- Art. 27 LDP
- Art. 29 LDP
- Art. 30 LDP
- Art. 31 LDP
- Art. 32 LDP
- Art. 32a LDP
- Art. 33 LDP
- Art. 34 LDP
- Art. 35 LDP
- Art. 36 LDP
- Art. 37 LDP
- Art. 38 LDP
- Art. 39 LDP
- Art. 40 LDP
- Art. 41 LDP
- Art. 42 LDP
- Art. 43 LDP
- Art. 44 LDP
- Art. 45 LDP
- Art. 46 LDP
- Art. 47 LDP
- Art. 48 LDP
- Art. 49 LDP
- Art. 50 LDP
- Art. 51 LDP
- Art. 52 LDP
- Art. 53 LDP
- Art. 54 LDP
- Art. 55 LDP
- Art. 56 LDP
- Art. 57 LDP
- Art. 58 LDP
- Art. 59a LDP
- Art. 59b PRA
- Art. 59c LDP
- Art. 60 LDP
- Art. 60a LDP
- Art. 62 LDP
- Art. 63 LDP
- Art. 64 LDP
- Art. 67 LDP
- Art. 67a LDP
- Art. 67b LDP
- Art. 73 LDP
- Art. 73a LDP
- Art. 75 LDP
- Art. 75a LDP
- Art. 76 LDP
- Art. 76a LDP
- Art. 90 LDP
-
- Art. 1 EIMP
- Art. 1a EIMP
- Art. 3 al. 1 et 2 EIMP
- Art. 8 EIMP
- Art. 8a EIMP
- Art. 11b EIMP
- Art. 16 EIMP
- Art. 17 EIMP
- Art. 17a EIMP
- Art. 32 EIMP
- Art. 35 EIMP
- Art. 47 EIMP
- Art. 67 EIMP
- Art. 67a EIMP
- Art. 74 EIMP
- Art. 74a EIMP
- Art. 80 EIMP
- Art. 80a EIMP
- Art. 80b EIMP
- Art. 80h EIMP
- Art. 63 EIMP
- Art. 80c EIMP
- Art. 80d EIMP
-
- Vorb. zu Art. 1 LPD
- Art. 1 LPD
- Art. 2 LPD
- Art. 3 LPD
- Art. 4 LPD
- Art. 5 let. c LPD
- Art. 5 let. d LPD
- Art. 5 lit. f und g LPD
- Art. 6 al. 3-5 LPD
- Art. 6 al. 6 et 7 LPD
- Art. 7 LPD
- Art. 10 LPD
- Art. 11 LPD
- Art. 12 LPD
- Art. 14 LPD
- Art. 15 LPD
- Art. 19 LPD
- Art. 18 LPD
- Art. 20 LPD
- Art. 22 LPD
- Art. 23 LPD
- Art. 25 LPD
- Art. 26 LPD
- Art. 27 LPD
- Art. 31 al. 2 let. e LPD
- Art. 33 LPD
- Art. 34 LPD
- Art. 35 LPD
- Art. 38 LPD
- Art. 39 LPD
- Art. 40 LPD
- Art. 41 LPD
- Art. 42 LPD
- Art. 43 LPD
- Art. 44 LPD
- Art. 44a LPD
- Art. 45 LPD
- Art. 46 LPD
- Art. 47 LPD
- Art. 47a LPD
- Art. 48 LPD
- Art. 49 LPD
- Art. 50 LPD
- Art. 51 LPD
- Art. 52 LPD
- Art. 54 LPD
- Art. 55 LPD
- Art. 58 LDP
- Art. 57 LPD
- Art. 60 LPD
- Art. 61 LPD
- Art. 62 LPD
- Art. 63 LPD
- Art. 64 LPD
- Art. 65 LPD
- Art. 66 LPD
- Art. 67 LPD
- Art. 69 LPD
- Art. 72 LPD
- Art. 72a LPD
-
- Art. 2 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 3 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 4 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 5 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 6 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 7 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 8 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 9 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 11 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 12 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 16 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 18 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 25 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 27 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 28 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 29 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 32 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 33 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
- Art. 34 CCC (Convention sur la cybercriminalité [Cybercrime Convention])
-
- Art. 2 al. 1 LBA
- Art. 2a al. 1-2 and 4-5 LBA
- Art. 2 al. 3 LBA
- Art. 3 LBA
- Art. 7 LBA
- Art. 7a LBA
- Art. 8 LBA
- Art. 8a LBA
- Art. 11 LBA
- Art. 14 LBA
- Art. 15 LBA
- Art. 20 LBA
- Art. 23 LBA
- Art. 24 LBA
- Art. 24a LBA
- Art. 25 LBA
- Art. 26 LBA
- Art. 26a LBA
- Art. 27 LBA
- Art. 28 LBA
- Art. 29 LBA
- Art. 29a LBA
- Art. 29b LBA
- Art. 30 LBA
- Art. 31 LBA
- Art. 31a LBA
- Art. 32 LBA
- Art. 38 LBA
CONSTITUTION FÉDÉRALE
CODE DES OBLIGATIONS
LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
CONVENTION DE LUGANO
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI FÉDÉRALE SUR LES DROITS POLITIQUES
CODE CIVIL
LOI FÉDÉRALE SUR LES CARTELS ET AUTRES RESTRICTIONS À LA CONCURRENCE
LOI FÉDÉRALE SUR L’ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
CODE PÉNAL
CYBERCRIME CONVENTION
ORDONNANCE SUR LE REGISTRE DU COMMERCE
ORDONNANCE SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
LOI SUR LE BLANCHIMENT D’ARGENT
LOI SUR LA TRANSPARENCE
LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS
Introduction
Le commentaire de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels est l’aboutissement d’un travail de groupe, réalisé par dix étudiantes et étudiants en Master de droit de l’Université de Genève. Les recherches et la rédaction ont pris place durant l’année académique 2024-2025, dans le cadre de la Clinique juridique en droit des biens culturels proposée par la Faculté de droit et avec l’accompagnement du Centre universitaire pour le droit de l’art. L’introduction a été rédigée par Laurence Amsalem, Esther Boccia, Camille Bögli, Xinyin Hu, Selly Lagun, Margaux Rod, Lisa Salama, Vincent Tschannen, Audrey Tschiffeli, et Eliane Vasseur.
1 Avec la création de l’État fédéral moderne en 1848, les cantons suisses ont vu leur souveraineté limitée dans les domaines expressément prévus par la Constitution fédérale, en matière culturelle notamment aux articles 3, 69 et 78 Cst. féd.
2 En cette absence de réglementation dans un pays situé au carrefour de l’Europe, entouré de puissants marchés culturels et financiers, un terreau fertile s’est mis en place pour le développement d’un commerce international d’art peu contrôlé. Ajoutons à cela un climat général de déréglementation dans plusieurs domaines, ainsi qu’une pression exercée par de puissants lobbys financiers : la Suisse est ainsi devenue, dans la seconde moitié du XXe siècle, une plaque tournante majeure du trafic illicite de biens culturels
3 Deux conventions internationales majeures ont marqué cette prise de conscience : la Convention UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (RS 0.444.1 ; ci-après : Convention UNESCO de 1970)
4 La Convention UNIDROIT de 1995, bien que perçue comme un prolongement de la Convention UNESCO de 1970, s’en distingue en posant des obligations civiles directement applicables, notamment en matière de restitution. Elle propose un régime plus strict et contraignant mais n’a été ratifiée que par 56 États, parmi lesquels la Suisse ne figure pas
5 Avant l’adoption de la LTBC, la Suisse ne disposait d’aucune norme fédérale régissant le commerce international des biens culturels
6 La LTBC, entrée en vigueur le 1er juin 2005, repose ainsi sur un socle constitutionnel solide et reflète une volonté claire d’ancrer la Suisse dans le cadre international de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Cette loi est complétée par des ordonnances d’exécution : l’Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (RS 444.11 ; ci-après : OTBC)
7 La LTBC a également introduit un certain nombre de mesures concrètes destinées à protéger le patrimoine culturel. Elle prévoit notamment l’établissement d’un inventaire fédéral des biens culturels importants, assorti de possibilités d’action en restitution en cas d’exportation illicite. Des mesures temporaires peuvent être prises en cas de menace exceptionnelle, et le devoir de diligence dans le commerce de l’art est formalisé à l’art. 16. Des mécanismes de coopération internationale sont instaurés, tels que les accords bilatéraux (art. 7), le soutien financier (art. 14), l’entraide judiciaire (art. 22–23), ainsi que des mesures de contrôle et de sanctions administratives et pénales. L’ensemble du dispositif vise à prévenir, dissuader et sanctionner les violations, tout en encourageant des restitutions volontaires.
8 Au fil du temps, la LTBC a dû évoluer, notamment en raison de la réforme du droit douanier en 2005
9 L’introduction des art. 4a et 24 al. 1 let cbis LTBC, ainsi que la modification des art. 2 al. 5 et 24 al. 1 let. c et d, et al. 3 LTBC, ont induit un élargissement du régime des sanctions et créé de nouvelles obligations, en dehors du cadre conventionnel initial.
10 Aujourd’hui encore, la jurisprudence reste limitée sur plusieurs notions centrales de la LTBC, laissant subsister une certaine incertitude juridique. En parallèle, une nouvelle dynamique politique a vu le jour. En 2022, le Conseil fédéral a annoncé la création d’une commission indépendante sur le patrimoine culturel au passé problématique
11 Malgré ces avancées, des critiques demeurent quant à la cohérence et à l’application pratique de la LTBC. La loi suisse a surtout un effet dissuasif et incitatif, plutôt que répressif, comme il ressort notamment de la lecture du rapport périodique soumis par la Suisse à l’UNESCO pour la période 2019–2022.
Le commentaire de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels est soutenu par :

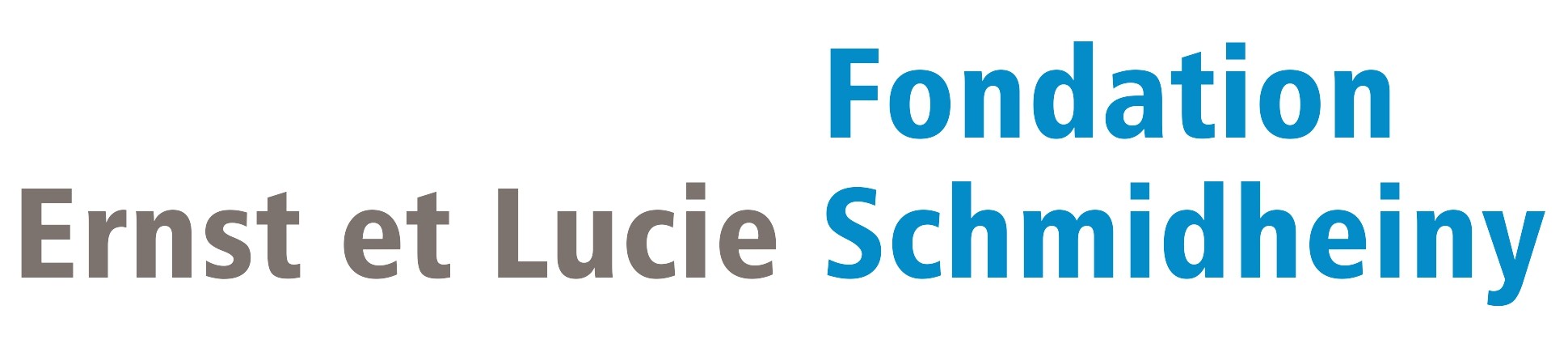

Bibliographie
Boillat Marie, Trafic illicite de biens culturels et coopération judiciaire internationale en matière pénale, Genève 2012.
O’Keefe Patrick J., Commentary on the UNESCO 1970 Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property, 2e éd., Leicester 2007.
Renold Marc-André/Contel Raphael, Rapport national - Suisse, in: Cornu, Marie (éd.), Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels - Étude de droit comparé Europe/Asie, Paris 2008, p. 323–428.
Torggler Barbara/Abakova Margarita/Rubin Anna/Vrdoljak Ana Filipa, Evaluation of UNESCO’s Standard-setting Work of the Culture Sector Part II – 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Final Report, Paris 2014, IOS/EVS/PI/133 REV.
Matériaux
Message du Conseil fédéral relatif à la Convention de l’UNESCO de 1970 et à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC), 21.11.2001, FF 2002 505 (cité : Message 2001)
Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement de la culture pour la période 2021 à 2024, du 26.02.2020, FF 2020 3037 (cité : Message culture 2021-2024)
Message du Conseil fédéral concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025-2028, du 1.03.2024, FF 2020 3037 (cité : Message culture 2025-2028)
Office fédéral de la culture, Rapport périodique national 2023 sur la mise en œuvre de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, Suisse, période de référence 2019-2022 (cité : Rapport périodique de la Suisse à l’UNESCO 2019-2022)